Nous avons vu ce phénomène à maintes reprises : « l’expert » de salon qui donne son avis même s’il a peu d’expérience du terrain.
Il y avait auparavant un dicton qui guidait la société civile canadienne : avant de porter un jugement sur une personne, essayez de vous mettre à sa place. C’est logique. Après tout, comment une personne peut-elle vraiment comprendre les circonstances ou les raisons d’un événement si elle ne l’a pas vécu ?
Cette marque de courtoisie de base est rarement accordée à la police au Canada, et de nouvelles recherches montrent à quel point la situation est devenue préoccupante.
Des commentaires injustement négatifs des médias et des commentateurs
Une nouvelle étude nationale réalisée par le Laboratoire sur les systèmes de stress et de traumatismes psychologiques (SSTP) a révélé pour la première fois que de nombreuses opinions du public, des médias et des experts de salon au sujet des services de police au Canada sont de plus en plus négatives et injustes, sans véritable justification factuelle.
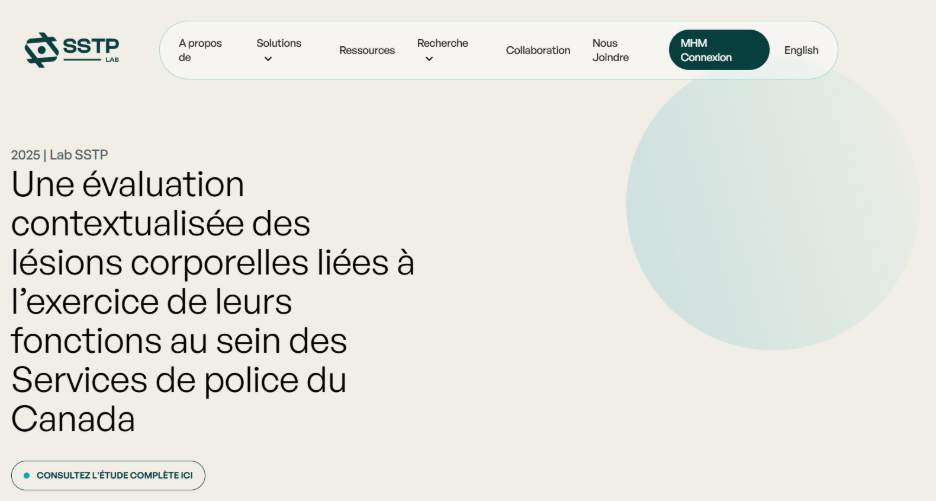
Dirigée par le Dr Nick Carleton, l’étude est la toute première analyse nationale détaillée sur les lésions corporelles graves survenues lors d’interventions policières et dépassant les normes légalement approuvées. Elle précise que les erreurs commises au moment de déterminer le recours à la force approprié sont extrêmement rares et qu’elles se produisent à un taux bien inférieur à celui des préjudices corporels comparables survenant dans l’exercice d’autres professions, comme dans le domaine des soins de santé, par exemple.
En langage clair, l’étude montre que la police au Canada agit de façon professionnelle, ne blesse pas illégalement les gens et que les médias ainsi que les commentateurs faussent négativement la perception du public à l’égard de notre police ; ils incitent les Canadiens à craindre la police en faveur de clics et de victoires politiques.

Ce n’est pas seulement du journalisme biaisé et un comportement non éthique de la part des experts : ces commentaires non informés et biaisés (intentionnellement ou involontairement) déstabilisent les institutions de confiance. Dans notre monde de plus en plus polarisé, ils peuvent engendrer des problèmes réels et durables. Ils minent la confiance entre le public et ceux qui ont pour mission de servir. Le public montre une hésitation injustifiée avant de recourir à ceux qui sont formés pour l’aider dans les moments les plus sombres.
Les décisions policières sont complexes, les commentaires les simplifient à l’excès
Les représentations dans les médias et les commentaires du public ou des « experts » négligent souvent la complexité du processus décisionnel de la police, surtout dans les situations à risque élevé qui mettent en cause la sécurité publique. L’étude a révélé que les préjudices graves impliquant des policiers ayant eu recours à la force dépassant les normes légalement approuvées se produisent dans moins de 0,001 % des interactions, soit 1 interaction sur 100 000. Pourtant, les récits publics blâment souvent les policiers.
Nous avons tous vu les titres d’article comme « L’agent Untel fait l’objet d’une enquête pour X », mais nous voyons rarement l’article de suivi selon lequel l’organisme de surveillance civile indépendante a conclu que la police avait utilisé la force appropriée pour se protéger ou protéger le public. En fait, au moment où l’article est publié (si les médias choisissent de le faire, ce qui se produit rarement), les dommages sont déjà faits et le policier impliqué est jugé coupable par le tribunal de l’opinion publique.
Les préjudices dans les soins de santé sont plus fréquents que ceux liés aux interventions policières
Le rapport a également examiné le seul autre ensemble de données de comparaison disponible : les professionnels de la santé. On a constaté que les préjudices corporels pendant les hospitalisations sont beaucoup plus fréquents que lors des interactions policières, et pourtant, cela est plus souvent attribué à des problèmes systémiques qu’aux médecins, au personnel infirmier ou au personnel.
En revanche, le public, les « experts » et les médias accusent trop souvent ou laissent entendre que les policiers ont agi de façon malveillante lorsqu’une personne est blessée. Pour les travailleurs de la santé, des erreurs semblables qui entraînent des préjudices corporels sont généralement considérées comme des accidents involontaires et donnent rarement lieu à un blâme individuel ou à un examen public.
De 2014 à 2023, les lésions corporelles graves impliquant des infractions de la politique ou du code de conduite, définies dans l’étude comme un « recours à la force excédant les procédures opérationnelles normalisées légalement approuvées » [traduction], se sont produites dans seulement 1,89 cas pour 100 000 incidents mettant en cause un policier (1 sur 53 000). À titre de comparaison, un préjudice corporel évitable pendant une hospitalisation a été signalé à un taux de 5 566,67 pour 100 000 (1 hospitalisation sur 18).
1 sur 18 comparativement à 1 sur 53 000. Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour savoir quelle proportion est la plus élevée.
Non, cette constatation ne signifie pas que le public et les médias devraient commencer à diaboliser les travailleurs de la santé. Ils sont aussi des héros.
À l’instar des professionnels de la santé, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les policiers de partout au pays ont choisi cette profession pour aider les gens. Ils sont empathiques, résilients et font preuve d’un esprit de communauté.
Les données contenues dans ce rapport ne signifient pas que nous devrions accorder une certaine indulgence à nos policiers ; elles montrent que nous devrions reconnaître activement à quel point ils agissent de façon extrêmement sécuritaire et professionnelle.
Il s’agit peut-être d’une opinion controversée en 2025, mais elle ne devrait pas l’être.
Formation des policiers : La désescalade avant tout et le poids des choix difficiles
Les policiers sont formés pour préserver la vie et n’utiliser la force que lorsque c’est absolument nécessaire pour se protéger et protéger le public. Ils suivent un modèle d’évaluation des menaces détaillé et approfondi qui oriente les interventions policières, axé sur la préservation de la vie et de la sécurité.
Chaque incident au cours duquel des policiers ont recours à la force fait l’objet d’un examen approfondi, notamment des enquêtes civiles indépendantes visant à assurer le respect des pratiques et des pouvoirs de la police.

Lorsque les policiers sont forcés de prendre des décisions difficiles lors de situations dangereuses et stressantes, ces moments les hantent souvent pour toujours, ce qui entraîne une montée en flèche du trouble de stress post-traumatique et d’autres problèmes de santé mentale chez les policiers (un autre sujet sur lequel les stratèges de salon et les médias préfèrent souvent se taire).
Comme cette nouvelle recherche le montre clairement, la grande majorité des interactions policières sont pacifiques, professionnelles et menées au service de la sécurité publique. Les policiers méritent notre soutien et non un jugement fondé sur la désinformation.


